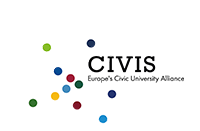Responsable : Nathalie Vanfasse (PR)
Membres de l’équipe :
Laurence BENARROCHE, Adam BIGACHE, Lucas CANTINELLI, Julian CARADEC, Frank CONESA, Cécile COTTENET, Kevin CRISTIN, Martin CRITELLI, Ilef DRIDI, Marie-Gaëlle DROUET, Léa FOURURE, Marie HEDON, Klaudia KOPIASZ, Anais MARTIN, Sylvie MATHE, Mounir TAIRI, Marryam THIRRIARD, Sophie VALLAS, Michel VAN DER YEUGHT
Présentation
« Histoire(s) et vies des littératures » s’inscrit dans une recherche sur et autour des littératures au sens large : la littérature dite « blanche », la littérature dite « grise » (textes de travail, brouillons, archives…) et le livre comme objet et résultat de diverses médiations. Cette recherche s’inscrit dans le sillage à la fois du tournant « matériel » et archivistique de la recherche en lettres et sciences humaines, dans le domaine des études des egodocuments et de l’intime, ainsi que dans celui qui relie la littérature à d’autres formes et modes de savoir et d’expérience.
Le programme « Histoire(s) et vies des littératures » (HVL) entend renouveler l’approche du livre et de la littérature, en les abordant dans une perspective intrinsèquement pluri- voire interdisciplinaire. Les travaux de l’équipe portent sur le champ littéraire, culturel et éditorial dans une acception très large. Ce programme global se décline en divers projets :
Médiation des littératures
Responsables : Cécile Cottenet, Sophie Vallas, Nathalie Vanfasse
Initiée en 2016, la réflexion sur les formes de médiation, et les médiateurs de la littérature se poursuit dans le cadre de « Histoire(s) et vies des littératures », selon des approches issues, en particulier mais pas exclusivement, des champs de l’histoire du livre et de l’édition et de la sociologie de la traduction. On cherchera à mettre en lumière les processus de médiation – interventions éditoriales, contractualisation, commercialisation, promotion, critique… – et les médiateurs (éditeurs, agents, directeurs de collection, critiques…) qui font advenir et promeuvent le livre, dans son champ de production d’origine aussi bien que dans un champ étranger. Le passage transatlantique de la littérature des États-Unis vers la France constitue un axe central de ce projet, qui prend forme dans le Dictionnaire des passeurs de la littérature des États-Unis en France.
Réalisations (en cours) : Dictionnaire des passeurs de la littérature des États-Unis (DicoPaLitUS, https://dicopalitus.huma-num.fr/)
Ce large projet collaboratif coordonné par Cécile Cottenet depuis 2019, impliquant aux côtés de chercheuses du LERMA, des chercheurs du CIELAM (AMU), CLIMAS (Université Bordeaux Montaigne), CREW (Université Sorbonne Nouvelle), Héritages (CY Cergy Paris Université), LISAA (Université Gustave Eiffel), et VALE (Sorbonne Université), s’attache à la circulation transatlantique des textes de littérature états-unienne et aux intermédiaires qui la rendent possible.
Littérature grise, littérature blanche
Responsables : Sophie Vallas, Maud Bougerol, Marie Hédon et Nathalie Vanfasse
Ce nouveau projet s’intéresse aux textes dits « gris » qui viennent en amont du texte littéraire « blanc », c’est-à-dire abouti, publié, légitimé par son existence officielle. Comment la littérature grise précède-t-elle, prépare-t-elle, pense-t-elle la littérature blanche ? Comment un travail sur la littérature grise (brouillons, manuscrits, notes de lecture et de travail, échanges et correspondances, entretiens…) peut-il venir éclairer la littérature blanche ? Comment cette littérature grise est-elle conservée, dans quels buts, et comment les humanités numériques peuvent-elles aujourd’hui aider à la préserver mais surtout à la mettre en valeur de façon dynamique, et ainsi rendre visibles les cheminements de la pensée, l’élaboration d’une œuvre littéraire ou universitaire, la construction d’un savoir ?
Les chercheuses au sein de ce projet travaillent sur des archives personnelles d’auteurs et/ou d’universitaires dans le champ de la littérature. Les archives de Marc Chénetier conservées au LERMA font l’objet d’un projet numérique cherchant tout d’abord à garantir la préservation de ce fonds exceptionnel et son accessibilité par les chercheurs intéressés par la littérature des États-Unis entre les années 1960 et les années 2010. Dans un second temps, le projet, qui considère l’archive d’un universitaire comme une forme d’autobiographie professionnelle, ambitionne de créer un site internet qui reconstituera et mettra en scène la biographie intellectuelle d’un chercheur, passeur de la littérature des États-Unis s’il en fut, ayant contribué à construire les études américanistes en France et en Europe. Plus largement, enfin, ce projet entend nourrir une réflexion sur l’apport des humanités numériques à la question de la présentation dynamique d’un fond d’archive aujourd’hui ainsi qu’aux nouvelles possibilités de son exploitation grâce à des outils permettant une multiplicité des croisements et des modélisations des données. En 2025, ce projet a obtenu un financement AMIDEX.
Les membres du projet s’intéresseront également aux archives explorées par les collègues dix-neuviémistes du groupe et aux manières dont elles peuvent être exploitées.
Littératures, passages, circulations et interdiscursivité
Responsables : Marie Hédon et Nathalie Vanfasse
Ce projet examine le texte littéraire en relation avec des discours et approches théoriques issus d’autres disciplines (comme l’économie). Le séminaire Litéco reprend ses travaux en les associant notamment au domaine de l’édition, ou au lien entre littérature et science, en collaboration avec le Centre d’éthique économique et de déontologie des affaires d’AMU ainsi qu’avec Bordeaux Sciences économiques et l’Université de Nantes.
Les passages et circulations des littératures font également l’objet d’un travail autour du texte littéraire sans distinction aréale (littérature états-unienne, anglaise, écossaise…) : littérature de la fin, autobiographie et paratexte, modes narratifs hybrides etc. Ces travaux se concrétisent également par un partenariat avec les universités de Berkeley et Montpellier, autour de la notion de « literature and forms of knowledge in the long 19th century ».
Passages, circulations et interdiscursivité à la fois entre les discours critiques et théoriques sur les littératures, entre les littératures et d’autres disciplines, mais aussi au sein des « formes » que prennent les littératures (réécritures, adaptation, écriture transmédiale, circulations entre frontières géographiques et temporelles) constitue donc le 3e volet du projet général.
Fondements théoriques et méthodologiques
Travail transversal à tous les membres de l’équipe.
Tous ces projets mobilisent, de diverses façons, l’enquête (sur les textes et leurs divers producteurs et diffuseurs, en archives, ou encore par le biais d’entretiens). Ils impliquent ainsi un volet épistémologique commun qui se décline de deux manières :
· Un volet de réflexion théorique sur l’histoire des littératures blanche et grise, de l’édition, des discours critiques, de la circulation des textes et de leurs dialogues avec d’autres disciplines
· Un volet pratique et méthodologique autour de la paléographie, la lecture, la conservation et l’exploitation de sources comme les archives, privées ou institutionnelles.
Pour plus d’informations sur l’équipe et ses projets, consultez son carnet de recherches: https://decentered.hypotheses.org/.
La page consacrée au séminaire CIVIS : CIVIS Seminar on contemporary Scottish Literature